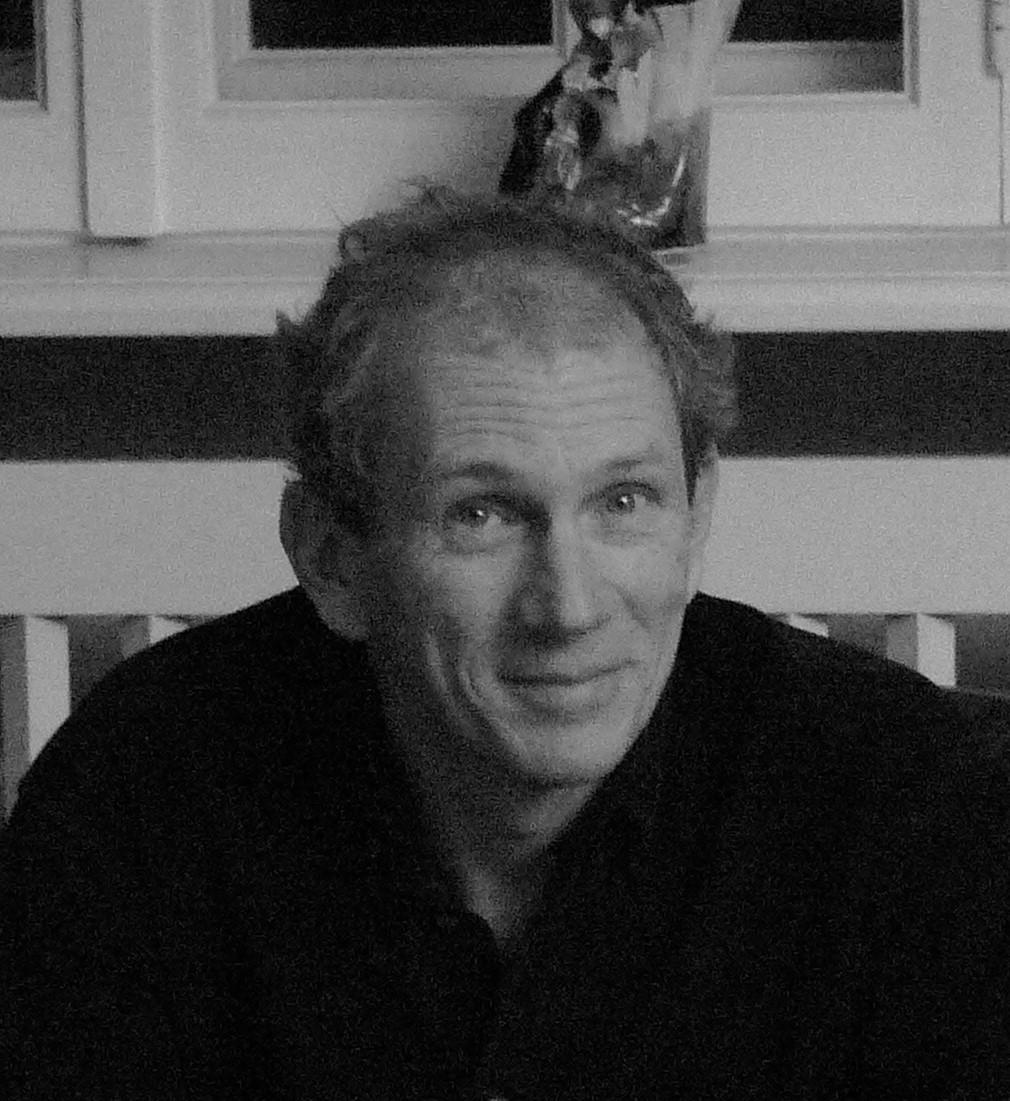Les chroniques économiques d’Eric du 8 Février 2019
« Tout affecte l’économie et l’économie affecte tout »
(Suite de ma dernière chronique où il était question de buveurs de bière)
Lors de ma dernière chronique, je vous avais exposé une anecdote démontrant à quel point un impôt excessif de redistribution s’avère contre-productif. Non seulement, il incite les plus riches à tricher ou quitter le pays, mais il pénalise à la fois les plus pauvres et les finances publiques.
Dans le même temps, nous constatons que les inégalités de richesse ne cessent de s’accroître et atteignent des proportions insupportables.
Ce paradoxe s’impose sur tous les continents, dans tous les pays et semble dans un contexte de compétition mondialisée insurmontable. Comment le résoudre ?
En préambule, rappelons que nous pouvons changer les choses. Nous ne sommes pas arrivés à cette situation injuste par hasard. Elle est le fait d’un certain nombre de décisions prises. Nous pouvons prendre de nouvelles décisions.
Le constat qui s’impose est le suivant : puisque le système de redistribution ne peut fonctionner au-delà d’une certaine limite, c’est à la source, avant la redistribution, qu’il faut limiter les inégalités.
Or, où se trouve la source d’inégalité ? Dans la cellule souche de toutes les économies du globe : l’entreprise. C’est à la modalité de répartition de la plus-value dégagée par les entreprises qu’il faut s’intéresser.
Inégalités capital/travail
Aujourd’hui dès lors que l’entreprise réalise un profit net d’impôt, l’essentiel de celui-ci revient aux investisseurs.
Imaginons le système suivant, appelons le régime de la Société à Partage Equitable (SPE) :
« Paul jeune entrepreneur enthousiaste, investit 100 000 € dans une société et recrute quatre personnes. Lui-même travaillant, il y a donc cinq salariés. Les résultats ne se font pas attendre et notre entreprise dégage un profit net.
Le principe de la SPE est le suivant : on divise le profit net en deux : 50% pour Paul et 50% pour les salariés. (Mais, pour rémunérer sa prise de risque on garantit à Paul les premiers 20.000€ (20 % du capital investi).
La première année le profit est de 30.000 €, Paul touche donc 20.000€ et les salariés se répartissent à parts égales* les 10.000€ restants soit 2000€ chacun y compris Paul.
La seconde année, le profit s’élève à 50.000 € Paul touche 25.000€ et les salariés se répartissent à parts égales les autres 25.000€, soit 5000€. »
*ou en fonction de critères choisis ancienneté, niveau de responsabilité...
Conclusions
• Les salariés touchent plus : 2000 € la première année et 5000€ la seconde. C’est mérité, ils ont contribué à la bonne santé de leur société.
• Paul (en tant qu’investisseur) touche sensiblement moins que dans le système actuel : 20.000€ au lieu de 30.000€ la première année et 25.000€ au lieu de 50.000€ la seconde. Mais,
• Cela reste une bonne rentabilité du capital investi (20% puis 25%)
• Ses salariés ont grand intérêt à la bonne marche de l’entreprise, ce qui accroît ses chances de profits supplémentaires, et ce qui diminue le risque d’échec
• Pour la même raison la valeur de l’entreprise s’accroit
• Nul doute que Paul s’attire rapidement les travailleurs les plus compétents, attirés par cet intéressement
• Dernière consolation : Paul en tant que salarié touche également 2000€ puis 5000 € supplémentaires
Ne serait-ce pas plus juste ? plus fraternel ?
Remarques :
• On peut imaginer que l’état pour encourager le choix citoyen de Paul en optant pour la « SPE », accorde une réduction fiscale.
• Ça peut être une option pour permettre un lancement de start up si Paul n’a pas les moyens de payer de gros salaires, mais promet un intéressement conséquent.
• On le constate, en aucun cas Paul ne perd même partiellement la responsabilité pleine de son entreprise. Il ne s’agit que d’un partage plus équilibré du résultat.
Bien sûr, je schématise pour la bonne compréhension du système et j’évite de rentrer dans de nombreux détails (possibilité ou nécessité de placer en réserve ou en capitaux propres les profits, report en cas d’année sans profits etc.). Aucun de ces détails ne pose de problème insurmontable. Mais il faudrait plusieurs pages d’explications et le principe général demeurerait inchangé.
La semaine prochaine, je vous proposerai une piste pour limiter une autre source d’inégalités celle des salaires disproportionnés.
Eric
PS : Pour ceux que la différence avec la participation gaullienne intéressent.
Le système SPE est différent de celui de la « Participation ». Dans l’esprit de de Gaulle, la Participation n’était pas qu’un partage du profit mais aussi une ntgestion participative, une association à la gestion, aux responsabilités. Attention, il s’agissait d’une époque où on changeait beaucoup moins d’entreprise, on était chez Michelin, Dassault, Felix Potin à vie. Ce n’est plus le cas.
Il faut bien distinguer trois choses, la répartition du résultat, la répartition des actions et le management de l’entreprise. Là où de Gaulle donne un petit peu de profit, un peu d’actions et un peu de pouvoir de décision. La « SPE » que j’imagine donne beaucoup d’argent (la moitié !) pas d’actions, et ne traite pas du management. Pourquoi ?
Concernant les dons d’actions ou part sociales
Aujourd’hui les salariés changent souvent d’entreprises. Autant leur donner tout de suite l’argent du résultat. En raison de la volatilité du marché du travail, donner des actions crée deux sources de problèmes :
• les revendre en partant ? Il n’y a pas toujours d’acheteur. A quels cours ? Il y aura forcement des gagnants et des perdants. On rentre dans de la paperasse et des conflits.
• garder les action en partant. Ce qui n’est pas dans l’esprit et surtout à la longue le capital de l’entreprise peut être si disséminé que cela peut être mortel pour la bonne gérance
on sait que dans ce cas les actionnaires ne pensent qu’aux dividendes au détriment du long terme (je l’ai vécu)
risque d’OPA pour les grandes sociétés
Bref, ça complique la vie du salarié, de l’investisseur, cela mène invariablement à beaucoup de paperasses et détourne chacun de l’attention qu’il doit porter au bon fonctionnement de l’entreprise.
Rien n’empêche les salariés qui le souhaitent :
• De laisser leur bonus en compte courant rémunéré par l’entreprise
• De participer à une augmentation du capital si l’actionnariat est d’accord (il peut vouloir fidéliser des salariés-clés ou avoir besoin de plus de capitaux propres)
Concernant le partage du management :
Je ne crois absolument pas à la cogestion. Comme à la guerre ou en politique mieux vaut un chef qui assume. En revange, je suis favorable à une information plus ouverte et un rôle consultatif donné à un collège de salariés. (dans les petites entreprise cela se fait le plus souvent naturellement)
Mais, je pense surtout que le management est un AUTRE problème, bien distinct de la répartition du profit qui doit et peut être traité séparément. En voulant résoudre les deux problèmes d’un coup on embrouille tout et on ne résout rien.
Dans la même rubrique
19 janvier 2019 – Les chroniques économiques d’Eric du 18 janvier 2019
14 janvier 2019 – Les chroniques économiques d’Eric du 13 janvier 2019
28 décembre 2018 – Chroniques économiques d’Eric du 27 décembre 2018
18 décembre 2018 – Chronique économique d’Eric du 18 décembre 2018
26 novembre 2018 – Chronique économique de la semaine du 19 novembre 2018